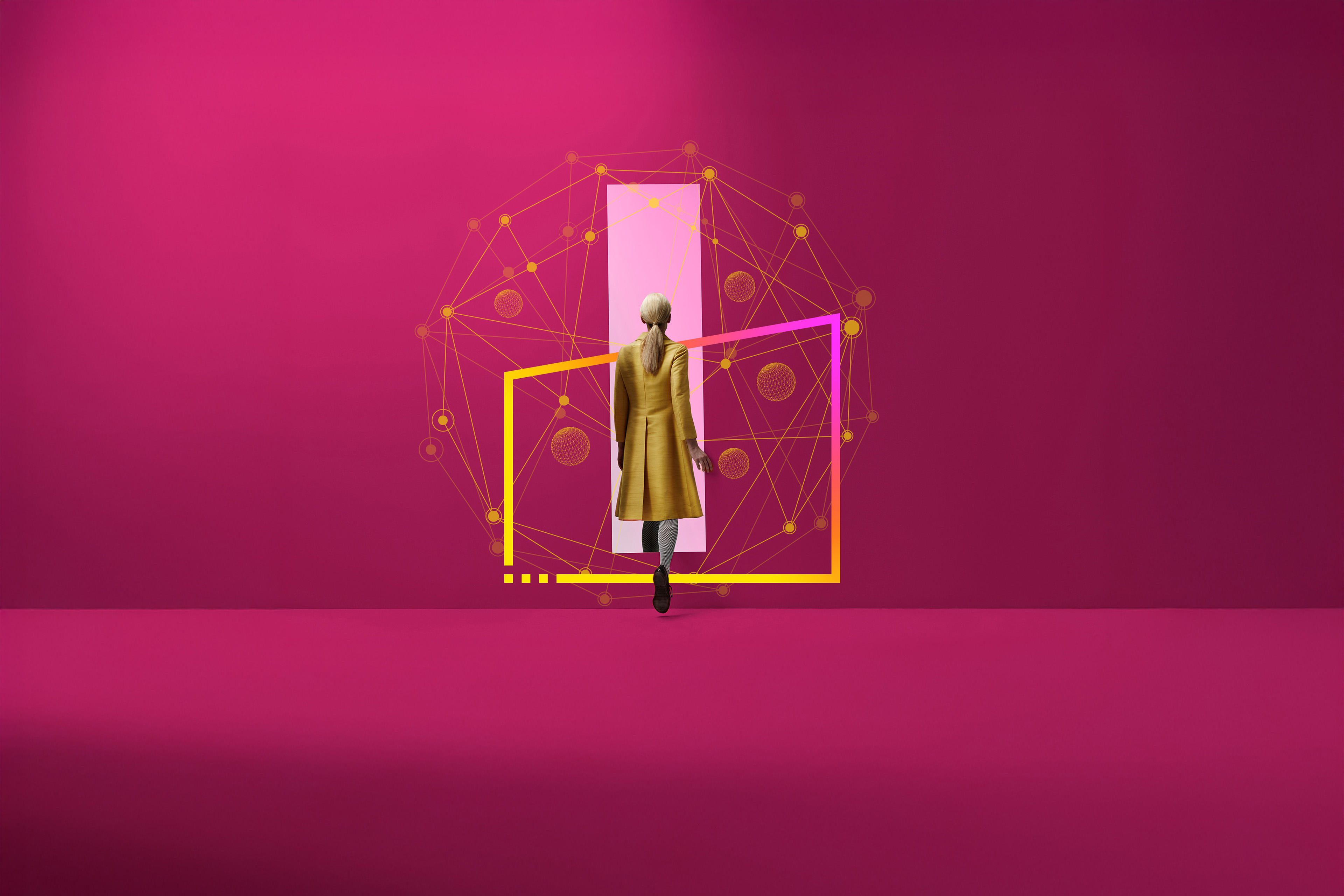EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients.

Protéger ses marques, brevets et idées dès le lancement est essentiel pour sécuriser sa start-up et en renforcer la valeur.
Start-up : stratégies pour protéger les innovations et les marques dès le début
Dans l'univers des start-up, l'agilité, la rapidité d'exécution et la capacité d'innovation sont souvent considérées comme les clés de la réussite. Pourtant, une autre dimension — moins visible mais tout aussi cruciale — conditionne la pérennité d'un projet entrepreneurial : la protection des actifs immatériels.
Idées, concepts, noms, logos, algorithmes, prototypes, savoir-faire… tous ces éléments constituent une richesse qu'il est vital de préserver dès les premiers pas de la start-up.
À défaut d'une stratégie claire et anticipée, de nombreuses jeunes entreprises se retrouvent exposées à des risques majeurs : litiges, copies, vols d'idées, ou encore blocages juridiques en phase de levée de fonds.
Dès lors, sécuriser ses innovations ne relève pas du confort juridique, mais d'un véritable levier de compétitivité et de valorisation.
Dans cet article, nous vous proposons une démarche structurée en trois axes, largement inspirée des meilleures pratiques observées dans les articles les plus reconnus sur le sujet.
Cartographier ses droits : première étape incontournable
Protéger efficacement ses actifs commence par une étape souvent négligée : l'identification précise de ce qui mérite protection. Contrairement à une idée reçue, toutes les créations ou inventions ne peuvent pas faire l'objet d'un dépôt officiel, mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas protégeables.
Il est donc essentiel d'effectuer un diagnostic complet des éléments stratégiques : nom de l'entreprise, nom de domaine, logo, design, algorithmes, bases de données, documents commerciaux, code source, contenus éditoriaux, inventions techniques, ou encore méthodes de prospection.
Une fois cette cartographie établie, la start-up peut mettre en place une stratégie de protection adaptée, articulée autour de trois axes : les droits enregistrables, les droits créatifs et techniques, et enfin la confidentialité.
Axe 1 : Sécuriser les titres de propriété enregistrables
Certains actifs peuvent être protégés par un titre officiel enregistré auprès d'un organisme compétent. Ces titres offrent une protection juridique forte, exclusive et généralement renouvelable, ce qui en fait un socle essentiel pour sécuriser l'identité et les produits de la start-up.
Le nom de domaine : une adresse vitale à ne pas négliger
Le nom de domaine constitue l'adresse numérique de l'entreprise. Il est la porte d'entrée vers les produits, services et contenus de la start-up. Malheureusement, de nombreuses jeunes entreprises découvrent trop tard qu'elles ne sont pas juridiquement titulaires du nom de domaine qu'elles utilisent.
Pour éviter cela, il faut veiller à ce que le nom de domaine soit enregistré au nom de la société (et non d'un prestataire, développeur ou associé), dès la création. La réservation doit s'accompagner d'une réflexion stratégique : quelles extensions choisir ? (.com, .fr, .io, .tech…), quelles déclinaisons réserver ? faut-il bloquer des noms similaires ou homophones pour éviter le cybersquattage ?
Une veille régulière permet ensuite de détecter d'éventuelles tentatives d'usurpation. Certains outils comme « DomainTools » ou « Namecheckr » permettent de surveiller les dépôts suspects.
Exemple concret : une start-up française a dû racheter à prix d'or (plus de 10 000 €) son nom de domaine à un tiers qui l'avait anticipé… et bloqué son lancement international.
La marque : un actif central dans toute stratégie commerciale
Le dépôt de marque permet de revendiquer un monopole d'usage sur un nom, un logo, un slogan, voire une couleur ou un son, dans un territoire donné. Elle joue un rôle essentiel en matière d'image de marque, de différenciation et de sécurité juridique.
Avant de déposer une marque, il est impératif d'effectuer une recherche d'antériorité, afin de s'assurer qu'elle n'entre pas en conflit avec une marque déjà déposée. Cette recherche s'effectue via les bases INPI (France), EUIPO (Europe), OMPI (international), ou encore TMView.
Le dépôt doit ensuite être rigoureusement préparé : il faut définir les classes de produits ou services concernés (selon la classification de Nice), et choisir les territoires où la protection est souhaitée. Une fois la marque déposée, elle est protégée pour dix ans, renouvelable indéfiniment.
Une erreur fréquente consiste à déposer la marque au nom d'un fondateur plutôt que de la société. Cela peut poser de sérieux problèmes lors du départ de cette personne ou lors d'un rachat.
Axe 2 : Protéger les créations et les innovations techniques
En plus des noms ou logos, les start-up créent souvent des produits, des designs, des contenus ou des innovations techniques qui méritent aussi d'être protégés. Selon leur nature, ces créations peuvent relever du droit d'auteur, du brevet, ou encore des dessins et modèles.
Le brevet : protéger une invention technique et valoriser l'entreprise
Le brevet est un outil puissant mais exigeant. Il protège une invention technique, à condition qu'elle soit nouvelle, inventive, applicable industriellement et non divulguée avant le dépôt.
La procédure de dépôt peut paraître complexe mais elle est structurée : il faut rédiger un dossier détaillé (mémoire technique, dessins, revendications), puis le déposer auprès de l'INPI ou de l'OEB. Un accompagnement par un conseil en propriété industrielle est vivement recommandé, car un brevet mal rédigé perd une grande partie de son efficacité.
Déposer un brevet peut coûter entre 5 000 et 10 000 €, mais cela représente un actif valorisable : de nombreuses start-up voient leur valorisation multipliée par deux grâce à leurs brevets.
Le droit d'auteur : un rempart souple mais efficace pour les créations
Contrairement au brevet, le droit d'auteur ne nécessite aucun dépôt officiel. Il protège les créations originales dès leur réalisation : code source, design, maquette, texte, musique, vidéo…
La seule condition est de pouvoir prouver l'antériorité et la paternité de la création. Pour cela, plusieurs solutions existent : envoi recommandé à soi-même, horodatage numérique, dépôt auprès d'un huissier ou via l'enveloppe Soleau électronique de l'INPI.
Il est également possible, pour certaines créations visuelles ou ergonomiques, de les protéger en tant que dessins et modèles, via un dépôt formel.
Axe 3 : Sécuriser la confidentialité et le secret des affaires
Tous les éléments stratégiques d'une start-up ne sont pas destinés à être enregistrés. Méthodes, savoir-faire, bases de données, business plan ou algorithmes internes ne sont pas toujours « brevetables » ou protégés par le droit d'auteur. Ils relèvent alors du secret des affaires.
Depuis la loi de 2018, le Code du commerce offre une protection juridique au secret des affaires, à condition que trois critères soient réunis : l'information n'est pas connue ou facilement accessible, elle a une valeur commerciale, et elle fait l'objet de mesures de protection raisonnables.
Les accords de confidentialité (NDA) : des outils simples et efficaces
Avant toute collaboration ou discussion sensible, la start-up doit systématiquement faire signer un accord de confidentialité (Non-Disclosure Agreement). Ce document, souvent court, crée une obligation de non-divulgation et encadre l'usage des informations partagées.
Un bon NDA comprend :
- une définition claire des informations confidentielles
- les personnes autorisées à y accéder
- la durée de l'engagement
- les sanctions en cas de violation
Les NDA doivent être signés non seulement avec les partenaires externes, mais aussi avec les salariés, les freelances, les prestataires, voire les investisseurs en phase de due diligence.
Exemple : une start-up ayant transmis son business model à un concurrent potentiel sans NDA n'a pu intenter aucun recours après que celui-ci l'a copié.
Instaurer une culture de la confidentialité en interne
Au-delà des contrats, il est crucial d'instaurer une culture de la confidentialité dans l'entreprise. Cela passe par des bonnes pratiques : cloisonnement des informations, gestion des accès, stockage sécurisé des documents sensibles, ou encore contrôle des outils collaboratifs.
Erreurs fréquentes et cas concrets
De nombreuses jeunes entreprises font des erreurs lourdes de conséquences :
- Déposer une marque ou un nom de domaine au nom d'une personne physique
- Ne pas surveiller les dépôts concurrents
- Révéler un prototype sans clause de confidentialité, notamment lors de concours de pitch ou de démonstrations publiques
- Oublier d’intégrer des clauses de cession de droits d’auteur dans les contrats des prestataires (développeurs, designers, etc.)
- Ne pas déposer de brevet en pensant que l’innovation ne sera « jamais copiée »
- Ne pas protéger les œuvres numériques en imaginant que « le code suffit »
Ces erreurs peuvent coûter cher, tant en opportunités qu’en contentieux. À l’inverse, les start-up qui prennent la protection au sérieux dès le départ se retrouvent souvent dans une meilleure position pour négocier avec des investisseurs, des partenaires ou des acquéreurs.
Cas concret 1 : la mésaventure d'une application non protégée
Une jeune start-up avait développé une application mobile innovante dans le domaine du bien-être. Faute de dépôt de marque, ni de NDA signé avec les premiers bêta-testeurs, l’idée fut copiée par un concurrent mieux financé qui lança un service identique quelques mois plus tard. Faute de preuves tangibles ou de titre de propriété, la start-up n’a pas pu faire valoir ses droits, ni obtenir d’indemnisation.
Cas concret 2 : une valorisation dopée grâce aux brevets
À l’inverse, une autre entreprise, spécialisée dans l’IoT, avait pris soin de déposer un brevet sur sa technologie de capteur de données, ainsi que des dessins et modèles sur le design de son boîtier. Lors de sa première levée de fonds, ces titres ont permis de rassurer les investisseurs sur la solidité de l’innovation et ont contribué à une valorisation supérieure de 40 % à celle initialement envisagée.
Protéger, c’est aussi anticiper la croissance et l’international
La protection de la propriété intellectuelle ne doit pas être pensée comme un acte ponctuel, mais comme un processus évolutif et dynamique. À mesure que la start-up se développe, ses besoins évoluent : nouveaux produits, extension géographique, embauche de salariés, partenariats technologiques, etc.
Il est donc utile de réévaluer régulièrement la stratégie de protection. Cela peut inclure :
- Le dépôt de nouvelles marques dans d’autres pays (notamment via le système de Madrid pour les marques internationales)
- Le dépôt de brevets dans d’autres territoires stratégiques
- L’audit régulier de la documentation contractuelle (cessions de droits, clauses de confidentialité)
- La mise à jour des pratiques internes de protection des données et des savoir-faire
- L’intégration d’outils de veille concurrentielle
Vers une stratégie globale de valorisation des actifs immatériels
Protéger ses innovations ne doit pas être vécu comme une charge administrative, mais comme un investissement stratégique. Ces actifs immatériels, une fois protégés, deviennent des leviers de croissance, de financement et de différenciation.
Voici quelques pistes complémentaires à envisager dans une stratégie globale :
La valorisation comptable des actifs immatériels
Les titres de propriété intellectuelle (brevets, marques, logiciels) peuvent, dans certains cas, faire l’objet d’une inscription au bilan comptable. Cela renforce la crédibilité financière de l’entreprise, notamment lors de levées de fonds ou de négociations bancaires. Il est alors nécessaire de faire appel à un expert-comptable ou à un évaluateur spécialisé.
La monétisation via la licence ou la franchise
Une marque protégée peut être exploitée non seulement en propre, mais aussi licenciée à des partenaires ou franchisés. Cette approche permet d’élargir son périmètre d’action sans mobiliser les mêmes ressources internes. De même, une technologie brevetée peut être concédée à des tiers sous licence, générant des revenus récurrents.
L’attractivité auprès des investisseurs et acheteurs
Les investisseurs, business angels ou fonds de capital-risque examinent très attentivement le portefeuille de propriété intellectuelle d’une start-up. Des actifs bien protégés témoignent d’une bonne anticipation, d’une barrière à l’entrée crédible et d’un potentiel de valorisation. À l’inverse, l’absence de stratégie IP peut refroidir un investisseur ou faire baisser la valorisation proposée.
Conclusion : anticiper pour mieux réussir
Dans un monde où l’innovation se diffuse à une vitesse sans précédent, la protection des idées, marques et savoir-faire n’est plus une option, mais une condition de survie et de succès. Pour une start-up, chaque dépôt, chaque clause, chaque NDA peut faire la différence entre la croissance et le décrochage.
Adopter dès le départ une stratégie claire, adaptée, évolutive et cohérente de protection des actifs immatériels, c’est poser les fondations solides d’un projet entrepreneurial pérenne et ambitieux. C’est aussi donner confiance aux partenaires, investisseurs, clients… et à soi-même.
Ce qu'il faut retenir
Une idée ne suffit pas : sans protection adaptée, une start-up s’expose à des risques juridiques et commerciaux majeurs. Ce guide propose une méthode concrète pour identifier, protéger et valoriser ses actifs immatériels dès les premières étapes du projet.
Articles associés
Baromètre EY du capital risque en France - 1er trimestre 2025
Analyse des investissements FrenchTech au T1 2025 : baisse de 19%, secteurs en tête, et stratégies pour naviguer dans l'incertitude économique.
Gérer la relation avec ses investisseurs après une levée de fonds
Après la levée de fonds, le vrai défi commence : bâtir une relation stratégique et durable avec ses investisseurs
L'accompagnement d'EY
-
Accélérez la croissance de votre startup grâce à des conseils fiscaux et outils de gestion adaptés à votre structure.
Plus