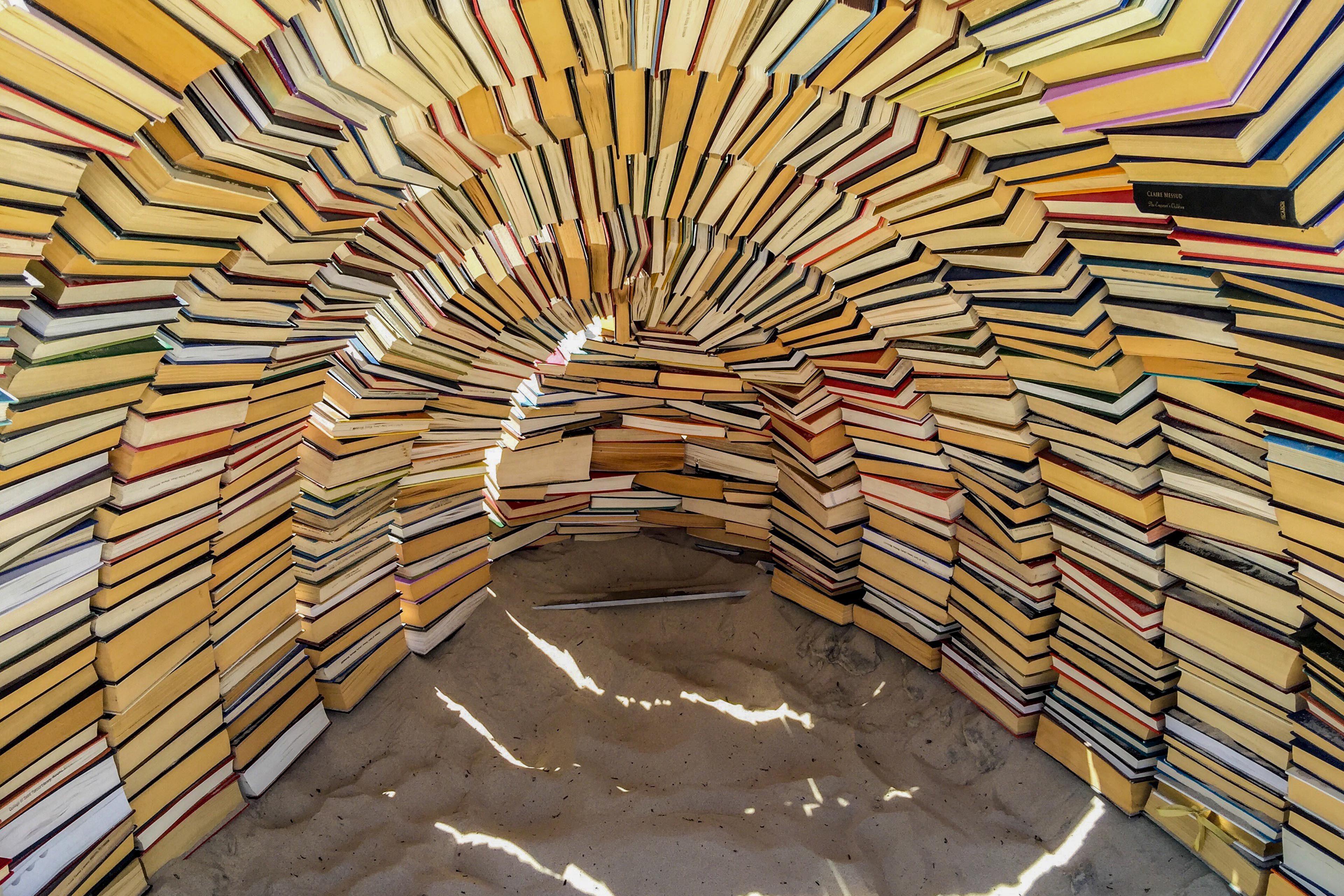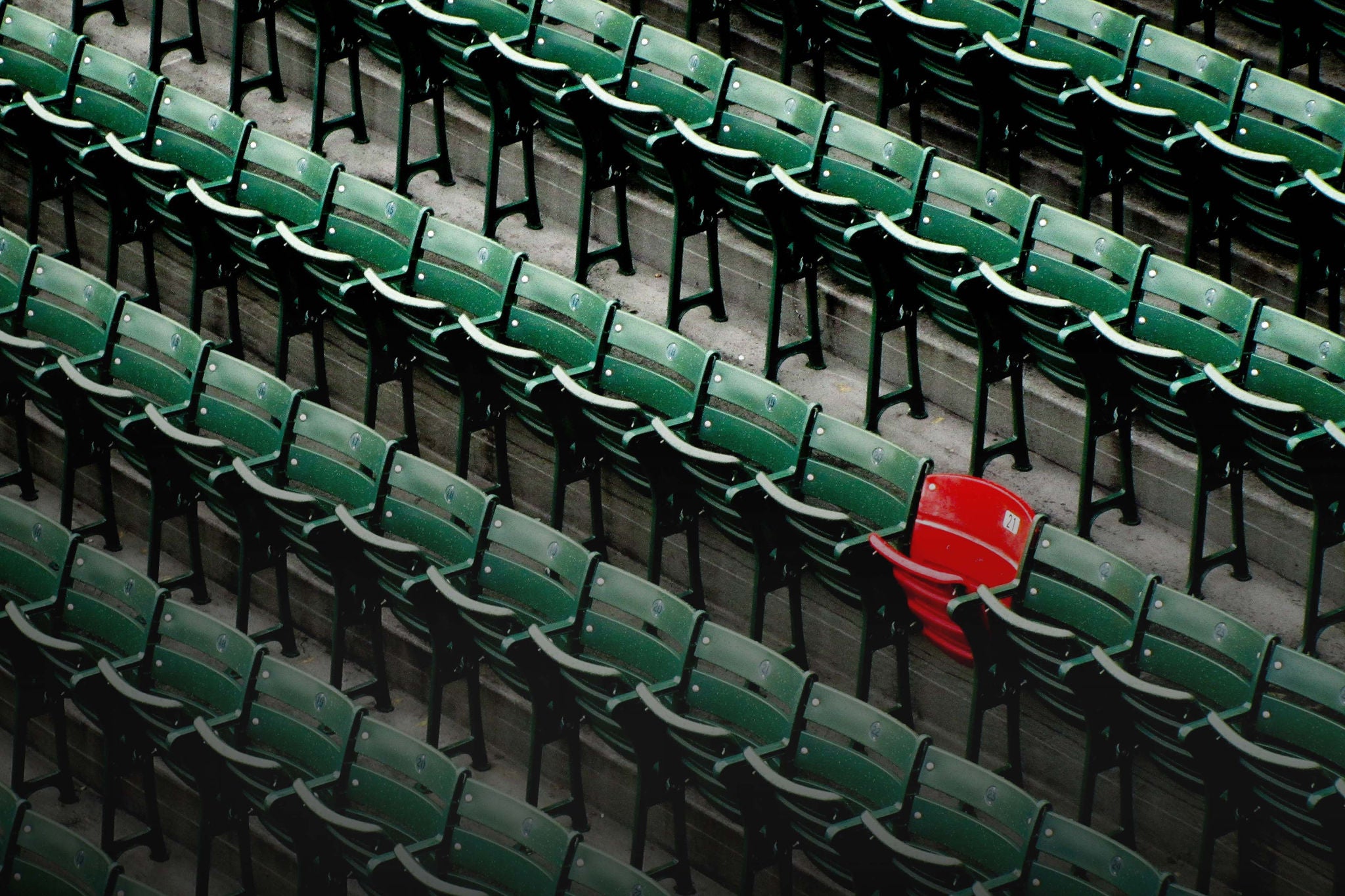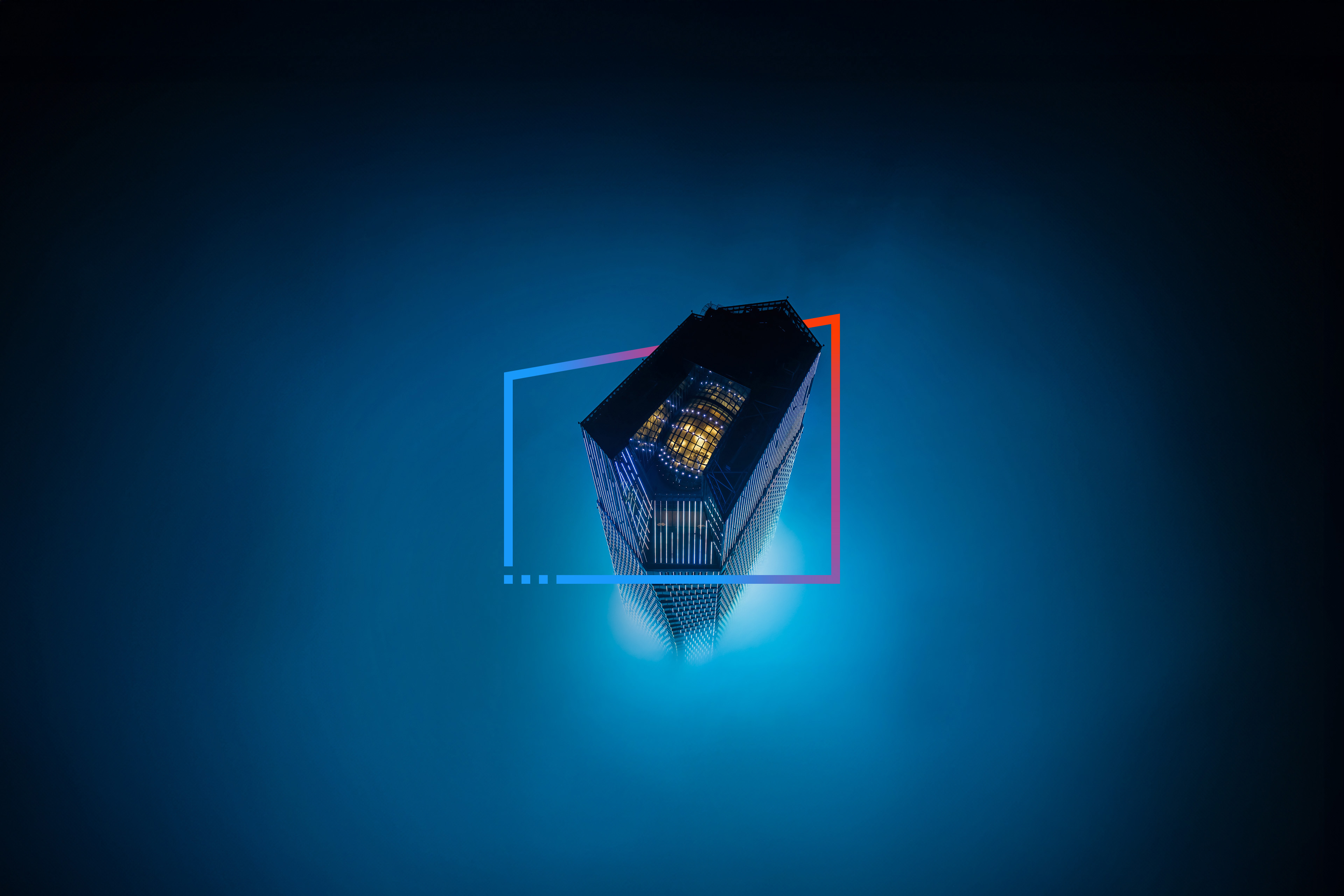Dans le plus récent sondage réalisé auprès des chefs de la direction en janvier 2024 (PDF), presque tous les chefs de la direction, soit 98 %, prévoyaient modifier leurs plans d’investissement stratégique en raison des défis géopolitiques. Au cours des dernières années, la guerre en Ukraine, le conflit au Moyen‑Orient et la réorganisation des systèmes d’alliances mondiales ont contribué à une volatilité géopolitique accrue. Et le supercycle électoral mondial de 2024, au cours duquel les électeurs représentant plus de 50 % de la population mondiale se rendront aux urnes, accroîtra les incertitudes géopolitiques, politiques et réglementaires. Bien que le contexte opérationnel mondial ne soit jamais statique, ce niveau de disruption géopolitique pose des défis importants aux entreprises internationales.
Les événements récents ont accéléré le virage vers un monde multipolaire. Mais rien ne garantit que cette trajectoire se poursuivra. La disruption et la volatilité géopolitiques devraient persister, ce qui aura également une incidence sur la croissance économique mondiale et l’inflation. En effet, de multiples forces disruptives façonnent l’environnement opérationnel mondial, y compris les changements climatiques, l’innovation technologique, les changements démographiques et l’influence croissante d’acteurs non étatiques. Cela crée des perspectives très incertaines pour l’avenir de la mondialisation.
Pour faire face à cette incertitude géopolitique, il est nécessaire de procéder à une analyse de scénarios, c’est‑à‑dire à l’exploration systématique de plusieurs avenirs envisageables. En élaborant la stratégie de leur entreprise, les chefs d’entreprise ne doivent pas se fier à une seule série de prévisions sur les perspectives de la mondialisation, car elles peuvent se révéler erronées. Ils devraient plutôt évaluer les incidences commerciales possibles et les impératifs stratégiques de plusieurs environnements opérationnels mondiaux alternatifs, plutôt que d’essayer de prédire un résultat précis.
En septembre 2022, dans le cadre de la série sur les impératifs des chefs de la direction, qui porte sur des questions et des mesures cruciales pour aider les chefs de la direction à redéfinir l’avenir de leur organisation, l’équipe du Groupe Activités géostratégiques d’EY‑Parthenon a analysé la dynamique géopolitique afin d’explorer les scénarios susceptibles d’émerger au cours des cinq prochaines années. Maintenant, un an et demi plus tard, l’équipe a réévalué cette analyse. La conclusion? Jusqu’à présent, ces scénarios ont résisté au temps et restent vraisemblables pour l’évolution de la mondialisation.
L’analyse d’EY‑Parthenon a relevé deux grandes incertitudes qui sont les principaux facteurs du contexte opérationnel mondial futur :
- Relations géopolitiques
Cette grande incertitude s’articule autour de la question cruciale de savoir si l’environnement géopolitique sera défini par des alliances souples ou par des blocs distincts. La réponse dépendra en grande partie de l’issue de la guerre en Ukraine et du positionnement géopolitique de la Chine. Les politiques des États‑Unis et de l’Union européenne joueront également un rôle crucial, notamment en ce qui concerne la force et la cohésion des relations transatlantiques. De plus, les politiques étrangères de divers États pivots géopolitiques, dont l’Inde, l’Arabie saoudite, la Turquie et le Brésil, contribueront à façonner les relations géopolitiques futures.
- Position en matière de politique économique
Les gouvernements interviennent de plus en plus dans leur économie nationale. La deuxième grande incertitude est de savoir si les pays continueront de favoriser une telle concurrence nationaliste ou si leurs politiques économiques se tourneront vers une libéralisation plus internationaliste. Cela dépendra de la mesure dans laquelle les gouvernements adopteront des politiques industrielles et élargiront le nombre de secteurs qu’ils considèrent comme stratégiques à l’échelle nationale. Ces décisions politiques seront, à leur tour, dictées par divers facteurs, notamment la sécurité énergétique, les répercussions des changements climatiques et la vigueur de la croissance économique.
Après avoir identifié les relations géopolitiques et les positions des pays en matière de politique économique comme les deux grandes incertitudes stratégiques mondiales d’aujourd’hui, nous nous sommes concentrés sur quatre scénarios vraisemblables pour l’avenir de la mondialisation, fondés sur le recoupement de ces questions.
- La « priorité à l’autonomie » résulterait du déclin des alliances et d’une faible croissance économique qui pousseraient les pays à promouvoir les productions nationales et à tenter d’être plus autosuffisants.
- La « deuxième guerre froide », quant à elle, résulterait d’un renforcement des alliances et d’une concurrence idéologique combinée à des politiques économiques nationalistes étatistes.
- L’approche axée sur « les amis d’abord » est également caractérisée par de fortes alliances géopolitiques, mais le commerce et le capital circulent relativement librement entre les alliés, ce qui amène les entreprises à faire de « l’amilocalisation », des principales activités d’exploitation et des chaînes d’approvisionnement.
- La « mondialisation allégée » fait référence à un contexte opérationnel plutôt libéralisé et mondialisé avec moins de tensions géopolitiques.